Mémoires des autres guerres.
Chroniques de l'occupation.
Dessin Hans Holbein
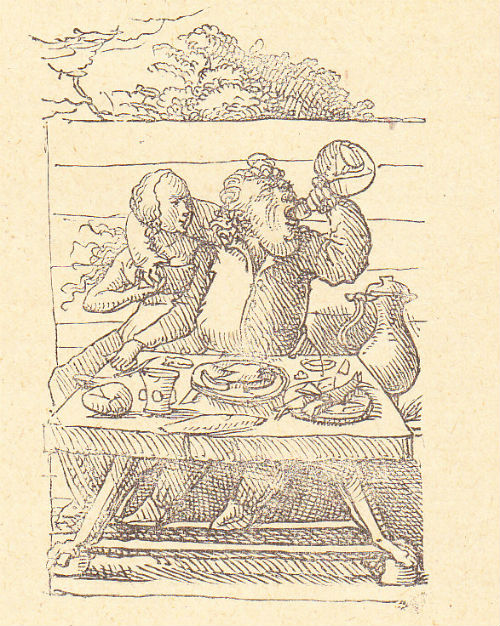
Notre malheureuse patrie, que Saint-Clou son patron la protège, fut étrillée par les troupes du pays voisin en l'an 19xx.. Il faut dire qu'elle est si petite qu'on la traverse en quelques heures en vélo et que son armée ne comprend qu'une centaine d'officiers et de sous-officiers, plus quelques soldats, mais tous très courageux. C'est pourquoi son belliqueux voisin, mille fois plus peuplé et mieux armé, l'a envahie en cinq heures et vaincue en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et encore, cela serait allé plus vite si nos troupes, au premier coup de feu, ne s'étaient pas cachées dans nos catacombes au lieu de se rendre.
Les journalistes, qui trouvent toujours les meilleures solutions après coup, ont fustigé l'incurie de nos gouvernants et la maladresse de notre état-major. Mais le mal était fait et par un froid matin d'avril, les troupes d'occupation, musique en tête, sont entrées dans notre capitale. Tout porte à croire qu'au même moment, elles entraient aussi dans les trente-huit autres villes et villages du pays. Dans la capitale, seule madame Yolande et ses filles, toutes très jolies et serviables, qui habitent une maison à l'enseigne du "Joyeux Roudoudou", firent la haie pour accueillir nos vainqueurs, agitant des petits drapeaux (ceux de l'ennemi) et jetant sous leur pas des fleurs roses en papier coloré découpées par leurs soins. Que voules-vous, les femmes de chez nous "aiment la force virile et l'odeur du vieux cuir", dit-on. Le reste de la population fit des provisions de pâtes, de sucre et de farine et se cacha, ou s'enfuit. Les blindés ennemis se dispersèrent dans la capitale pour se mettre en position dans nos quatre principaux carrefours. Sanglés dans leurs combinaisons de combat noires, quelques soldats ennemis installèrent promptement, près des blindés -on ne sait jamais- des abris en sacs de sable afin d'être tout à leur aise pour regarder de travers les rares passants et exiger tenue correcte, surtout chez les dames, papiers en règle et les tout récents laissez-passer : « Papirus zou ! ». Après s'être prosternés dans la vieille mosquée et récité une prière de remerciement, le reste de la troupe fila vers les deux casernes, deux villas en réalité désertées par leurs habitants et s'y enferma. L'occupation débutait d'une manière des plus classiques.
À onze heures, une petite limousine noire, escortée de camionnettes Toyota armées de mitrailleuses de moyen calibre, s'arrêta devant le Palais du Peuple, siège de la Présidence de notre pays. Il en descendit un petit général en tenue d'apparat avec sabre, casoar jonquille, fourragères à aiguillettes d'or et épaulettes d'argent. Un photographe de notre agence de presse nationale, surgit de derrière une colonne où il se cachait et prit trois clichés de l'envahisseur avant de décamper sur son vélomoteur. Ce fut le premier acte de résistance de nos journalistes lesquels décidèrent par la suite, enfin ceux qui étaient restés au pays, de publier coûte que coûte un quotidien impartial qui serait vendu devant la cathédrale, à la sortie de la messe de sept heures.
Le général ennemi sembla surpris par le geste de notre photographe-résistant et leva ses sourcils qu'il avait fournis d'une manière interrogative. Il faillit même se coincer les pieds dans son grand sabre en prenant trop hâtivement la pose face au photographe. L'Histoire faisait pénétrer dans le Palais du Peuple un individu de taille très moyenne, pour ne pas me répéter, gros de ventre et court de jambes qui n'avait pas non plus un visage très remarquable. La tête était ronde, en partie dégarnie de cheveux grisonnants sur le sommet, le sourcil comme nous l'avons dit, la barbe grise et courte, les joues grasses et roses, la dentition bien plantée et saine. L'homme devait avoir une soixantaine d'années et on reconnaissait qu'il était soldat de carrière à l'usure du dard terminant son fourreau de sabre et au nombre de ses médailles. La seule chose extraordinaire et surprenante dans cet homme ordinaire était son nez. Bourgeonnant, gros et long, veiné de violet, criblé de trous comme la lune. C'est un nez de soudard qui a beaucoup bu et reniflé le sang de ses victimes, donc un nerz de tyran, écrivirent les journalistes dans leur premier numéro clandestin. Ils comparèrent ce nez à celui de Néron, d'Attila et même de Panturle, notre despote national qui fit, en son temps, tant couper de têtes après avoir dûment fait empaler leurs propriétaires.
Le général fit ensuite un pas en avant, sans effort apparent, ni gêne autour de la colonne vertébrale et sans claudication d'aucune sorte. Il gravit sereinement en sifflotant le haut escalier qui mène au péristyle, de tournure grecque, lequel ouvre sur l'intérieur du Palais. Un homme bossu, fluet, chafouin, laid et brun de peau l'attendait en ployant sa maigre échine à quatre-vingt-dix degrés.
– Etes-vous le président de ce pays ? s'enquit poliment le général d'une voix neutre et normalement grave.
– Le président s'est enfui hier au soir, répondit la voix aigre et haut perchée du bossu, avec tout son gouvernement et seul Dieu, qu'il soit mille fois encensé, sait où il se trouve présentement. Je suis le concierge du Palais, ajouta-t-il en se redressant du mieux qu'il put.
– Fort bien, répondit le général, veuillez me précéder et m'ouvrir les portes du palais.
Il visita le bâtiment durant deux bonnes heures, faisant sonner son sabre et ses éperons sur les dalles de marbre. Il toussota légèrement en découvrant les luxueux tapis turcs, les toiles des meilleurs peintres français du dix-neuvième siècle, essentiellement des nus féminin coiffés de casques et portant arcs et carquois dans un décor champêtre, les gravures et sculptures italiennes, des nus effrontés là aussi mais sans casque ni carquois, qui décoraient l'antichambre et le bureau du président. Il posa son sabre sur la table de travail marquetée et vierge de tout papier, jeta son képi sur une bergère napoléonienne prenant ainsi, avec détermination et sans coup férir, la place encore tiède affirmeront les journalistes-résistants, du président-chef du gouvernement en fuite. Il choisit d'occuper les appartements de son prédécesseur sans y changer quoi que ce soit. Même le pot et la chaise percée restèrent à leur place à quelques pas du lit présidentiel. On eut dit que le palais avait été construit décoré et meublé pour lui. Il déjeuna dans son bureau d'un poulet froid, de pommes de terre tièdes et but, exceptionnellement, du vin rouge extrait de la cave du palais par le bossu.
Dans l'après-midi, arrivèrent ses ordonnances et aides de camp en uniforme de mamamouchi -turban rose et babouches dorées-, ses serviteurs dont un géant, un mamelouk de plus de deux mètres armé de divers coutelas, et des secrétaires qui se chamaillèrent sur la distribution des chambres et des bureaux. Le bossu prit l'initiative des hébergements et parvint à contenter tout le monde. C'est qu'il ne voulait absolument pas que soit occupée une petite pièce voisine du bureau du général. C'est, je vous le livre sous le sceau du secret le plus absolu, de cette pièce qu'il écoutait en catimini, depuis dix ans, tout ce qui se disait chez le président. Pour notre bossu, cet emplacement stratégique était à l'origine de nombreuses amitiés flatteuses et de gratifications généreuses. Il espérait l'utiliser encore, et de façon anonyme quel que soit l'occupant des lieux. Pour éviter que l'un des bouillants capitaines, qui formaient l'escorte du général, ne s'avise de s'y établir, le bossu y installa sa loge avec ses plantes vertes, ses balais et ses serpillières. Le lendemain il fut convoqué par le général.
– Faites venir les membres du Conseil, exigea ce dernier.
– Enfuis, mon général.
– Alors les Corps Constitués, la Justice, les hommes de Dieu et les Universitaires.
– Enfuis eux aussi.
– Baste ! Ne reste-t-il pas quelques hauts fonctionnaires de l'administration ?
– Enfuis parmi les premiers, monsieur le Général.
Le général soupira, Inch Allah, sa tâche allait être ardue.
- Je crois malgré tout qu'il reste un petit fonctionnaire de police, hasarda le bossu.
Le général en fut ému aux larmes. Enfin il n'était plus seul.
– Priez-le de venir.
Le policier arriva dans les cinq minutes. On aurait pu croire qu'il attendait sous le péristyle. Avant que le général ait pu prononcer un mot, le fonctionnaire s'aplatit littéralement devant lui et frappa le marbre de son front en bénissant trois fois le Saint Nom de qui vous savez.
– Je connais tout le monde dans le pays et je peux vous être fort utile, chuchota-t-il. Je saurai démasquer ceux qui s'opposeront à Votre Justice et à Vos Lois et je les châtierai moi-même, s’il plait à votre Excellence de m'en donner la liberté. Ni vu ni connu, même leurs mamans ne feraient pas mieux... Signe d’une grande perversité, le policier ricana en biais et se frotta les mains qu'il avait huileuses comme un cornet de frites belge. Je ferai respecter Votre parole et celle de nos Vainqueurs jusque dans les mosquées et les marabouts les plus pourris comme dans les villages les plus lointains. Je serai si impitoyable que, auprès de moi le loup le plus détraqué passera pour un agneau. Même Panturle...
Le général toussota et congédia d'un geste le fonctionnaire qui, après cent courbettes, aussitôt dehors se nomma Chef de la police secrète en exigeant un bureau près des caves du palais. Le bossu, naturellement, n'avait pas perdu un mot de ce qui s'était dit. La nuit était à peine tombée qu'un membre du Conseil, rentré subrepticement au pays, sollicita une entrevue par l'intermédiaire du bossu. Le général, en robe de chambre prune, buvait une tisane de tilleul en tisonnant un feu de tourbe dans son bureau. Le conseiller fut vivement impressionné par cette évidente simplicité qui ne pouvait cacher qu'une poigne d'acier des plus intraitables.
– Comment vous portez-vous ? lui lança le Général.
L'autre, un spécialiste en finances internationales, vit dans cette question comme un reproche déguisé. Il imagina des sous-entendus sur sa fortune en relation avec les comptes publics. Alors, pour amadouer l'occupant et se venger de quelques vieilles querelles, il donna par écrit les cachettes de tous les autres Conseillers. Il ajouta, sur une liste à part, les noms des habitants qui avaient favorisé leur fuite ainsi que ceux des patriotes et sympathisants de tous poils qu'il recommandait de neutraliser au plus tôt. Le Général toussota et le Conseiller comprit qu'il était absout. Alors s'enhardissant, il quémanda la place de "Conseiller Spécial pour les Affaires Extérieures Auprès de l'Occupant", poste qu'il guignait depuis l'armistice et dont il avait rédigé la fiche de poste depuis sa cachette.
- Faites, soupira le Général.
Le bossu nota la conversation sur un petit carnet noir. Le lendemain matin, un facteur déversa sur la table du général un plein sac de lettres de dénonciations, écrites et postées en ville durant la nuit. Car chacun, dans le pays, avait à cœur de montrer à l'occupant qu'il participait à son effort d'assainissement des mœurs en dénonçant, après de cruelles hésitations, écrivait-il, la morale défaillante et le mauvais état d'esprit d'un voisin ou d'un parent proche. Le chef de la Police Secrète en fit ses choux gras et emprisonna à tour de bras dans le sous-sol...
Ainsi coulèrent les premiers jours. Un matin, le général qui s'ennuyait, souhaita jouer aux échecs. Le chef de la Police secrète réquisitionna tous les jeux d'échecs du pays, puis voyant qu'il s'était trompé, réquisitionna tous les joueurs d'échecs qui subirent au préalable un interrogatoire de routine dans les caves du Palais. Une autre fois, ce furent les femmes qui furent réquisitionnées pour le général. D'abord les brunes, puis les blondes et pour finir les rousses, selon des tranches d'âge aléatoires jusqu'à ce que l'on comprenne enfin qu'il s'agissait de lui trouver une femme de chambre.
Entre temps les magistrats, le grand imam et ses secrétaires, les militaires ainsi que les universitaires étaient revenus au pays, apparemment aiguillonnés par le remord et soucieux d'assumer de nouveau leur mission comme de s'acquiter de leurs devoirs. Ils emplissaient, comme par le passé, le palais et ses antichambres de disputes, de jacasseries et de criailleries et il fallait tout le zèle des multiples Conseillers, eux-aussi de retour, pour les écouter tous. Les saisons passèrent et l'occupant finit par se lasser d'occuper, poussé dehors comme on dit par "la pression internationale" l'ONU et les Etats Unis qui agirent directement sur le Sultan, notre voisin dans son pays, en le privant d'hélicoptères, de bombes et de médailles.
Notre général-gouverneur, comme tout un chacun vieillissait et regrettait son village, sa maison, ses dromadaires aux yeux tendres et ses quelques amis restés là-bas. Il se félicita donc de la décision de son maître malgré les sympathiques jeunes filles du "Joyeux Roudoudou" invitées régulièrement au palais lors de repas fins entre gens de bonne compagnie. Je n'en dirai pas plus. Avant de quitter notre pays et de rassembler ses troupes pour un défilé d'adieu, il décida d'accomplir une action symbolique qui témoignerait pour l'Histoire de son passage chez nous. Il fit remplacer sur tous les clochers, les monuments et les drapeaux, le coq fier et vibrant qui jusqu'alors servait d'emblème à notre peuple, par un délicieux petit lapin courant au regard malicieux et à la queue ma foi en forme de houppette à poudre du plus bel effet. Le pays tout entier applaudit à tant de sollicitude et de bon goût. Il se trouva même des intellectuels, dont le célèbre Béhachelle, pour vanter l'intelligence proverbiale du lapin et blâmer les fanfaronnades du coq, lesquelles, on l'avait bien vu, ne peuvent mener qu'au désastre.
IL ne restait plus au général qu'à mettre en place son successeur avec ce que cela supposait de tractations et de négociations épineuses parmi l'élite du gouvernement et les chefs de partis. Par bonheur, il n'en fut rien, le bossu, alors que rien ne le laissait prévoir, reçut l'aval unanime des conseillers, des militaires et des membres des corps constitués. Il règne depuis sur notre merveilleux petit pays avec une sagesse et une pertinence exemplaires, avec l'aide cependant du Saint Nom de qui vous savez et du Chef de la Police Secrète car il ne peut y avoir de liberté vraie que sous la contrainte. Une maxime qu'il a fait apposer sur tous nos billets de banque et aux frontons de tous les édifices publics.
Personnellement, j'occupe son ancienne loge, tout près du bureau de son Excellence.
Jean-Bernard Papi ©
Personnellement, j'occupe son ancienne loge, tout près du bureau de son Excellence.

Jean-Bernard Papi ©