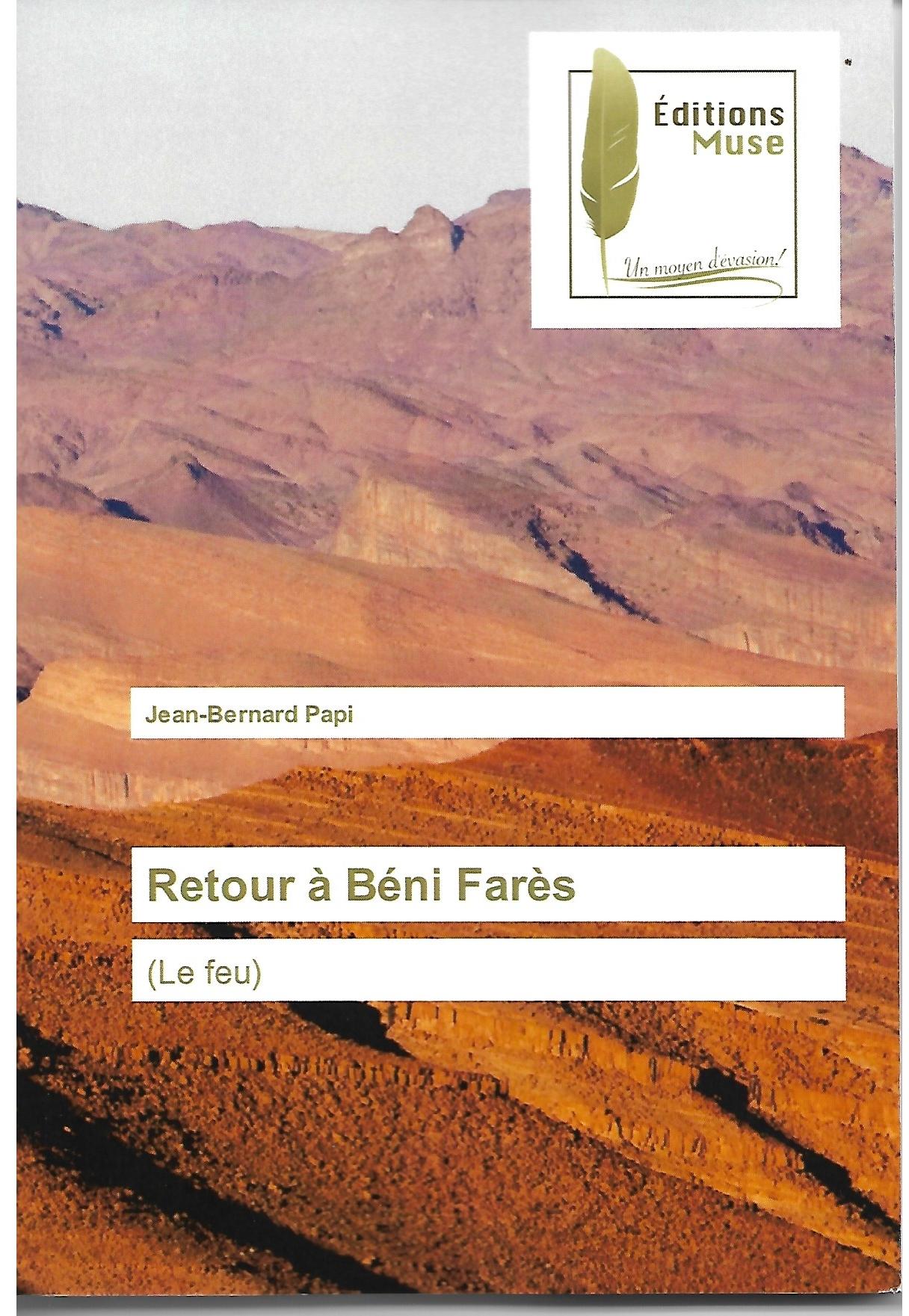

Retour à Béni Farès.
Couverture et 4ème de couverture
Additif à Retour à Béni Farès.
Dans les premières pages du roman Retour à Béni Farès, un feu ardent est dessiné sur toute la page, un genre de feu de camp, c’est aussi un rappel du sous-titre du roman : (le feu). Un feu dont on verra l’importance tout au long du roman. Ce feu est aussi un symbole qui traverse la totalité du roman si l’on veut bien chercher à le reconnaître sous la désinvolture du style. Par exemple :
- C’est le feu qui projette l’ombre des objets, auxquels ils n'ont pas accès, sur la paroi de la caverne et devant les yeux des habitants de Béni Farès qui s’y trouvent cloitrés pas forcément de leur plein gré.
- C’est le feu qui redonne confiance et dont la chaleur permet d’espérer un mieux dans un avenir inconnu. C’est aussi autour du feu que se réunissent les habitants avant de prendre les décisions collective. Un dieu qui éclaire et qui sera le garant et le témoin.
- C’est hélas ! le feu qui réduit en cendre le réel tout en permettant de prendre un nouveau départ. - C’est le feu qui démasquera le mal supposé et provoquera le destin.
Ce feu appartient à une trilogie romanesque qui comprend : Les yeux verts (la terre) et Naufrage d’un autobus (l’eau).
La critique de Pierre Peronneau (Le Boutillon des Charente N°78)
Retour à Béni Farès (Jean-Bernard Papi) Décidemment les auteurs saintongeais sont en forme. Après Jacques-Edmond Machefert, c’est Jean-Bernard Papi qui nous régale avec son nouveau roman. Les lecteurs et les lectrices du Boutillon qui apprécient les nouvelles de Jean-Bernard Papi devraient aimer ce roman. L’histoire se déroule dans un pays imaginaire, l’Esperanza, dirigé par une « compagnie » composée de personnages (hommes et femmes) incompétents et corrompus. La capitale du pays est Contantz, et la monnaie est le zozo. Le héros de l’histoire s’appelle Damien. Et le responsable de la compagnie, Michon, décide de l’envoyer pendant un mois à Béni Farès, un village d’éleveurs de moutons sans aucun confort (ni eau, ni électricité, ni véhicules à moteur), un bled perdu au pied des montagnes dans lesquelles se cachent des rebelles. Damien y est accueilli avec méfiance par Ali, un homme qui parait être le chef, tout simplement parce qu’il est le plus riche du village, et qu’il donne des ordres à ceux qui sont à ses côtés et qui s’appellent tous Mohamed. En réalité, oublié par la compagnie, Damien restera plusieurs mois à Béni Farès, ce qui lui permettra de se faire accepter par la communauté. Le chapitre dans lequel Ali demande à Damien de lui apprendre à conduire, simplement à l’aide de chaises mises côte à côte, en simulant le volant, le frein et le clignotant, est un grand moment d’humour. Je ne vais pas vous raconter la suite, tragique pour le héros et les habitants du village. Jean-Bernard Papi en profite pour dénoncer la bêtise, la malhonnêteté, et la corruption. Le pays est imaginaire, mais l’histoire est d’actualité. Il dénonce surtout le fanatisme religieux, pas seulement du côté des Islamistes : c’est une armée commandée par des fous et des hystériques dignes de la Sainte Inquisition qui va détruire le village, sous des prétextes fallacieux. Une histoire tragique, mais une bonne dose de cet humour corrosif propre à Jean-Bernard Papi, humour nécessaire compte tenu des situations absurdes dans lesquelles sont plongés les protagonistes. Bref, on ne s’ennuie pas à la lecture de ce roman. Pierre Péronneau (Maît’ Piârre) Retour à Béni Farès, de Jean-Bernard Papi (éditions Muse) – 139 pages – 26,90 euros
À commander sur : www.morebooks.shop

Préambule de "Retour à Béni Farès".
On s’entretua dans les montagnes Zebzeb, au nord d’Esperanza. L’évènement eut lieu il y a une cinquantaine d’années. Tueries que certains journalistes d’Esperanza, mal informés, qualifièrent à tort, de guerre de religion. Ce fut, en réalité, une guerre de conquête. L’impuissance endémique de l’Etat espéranzais à se défendre fut mises à profit par le gouvernement de Tenebra, pays voisin, pour l’envahir sous le prétexte fallacieux que les Espéranzais étaient des mécréants qu’il fallait convertir. Ce point de vue propagé et encouragé par les prêtres de Tenebra faussa notablement l’opinion des journalistes de tous bords. Il faut dire que dans Tenebra la religion primait sur tout et on adorait d’autant mieux le dieu local, un barbu (qualifié par ses adorateurs de « Vrai Dieu ») que celui-ci flanquait à ses fidèles de sévères coups de triques plusieurs fois l’an. « S’Il nous punit c’est qu’Il nous aime ». Profitant d’une tempête au large, c’était une vague géante qui ratiboisait, en une nuit, le plus grand des ports maritimes de Tenebra. Une autre fois c’était un tremblement de terre de force sept qui démolissait aux trois-quarts sa capitale El Moca. Parfois c’étaient des inondations qui se combinaient avec une épidémie de choléra ou avec une invasion de sauterelles venues de l’extrême Sud, lesquelles dévoraient les récoltes qui n’étaient pas sous l’eau. Les habitants avaient beau faire pénitence et jeuner un jour sur deux ce n’était jamais suffisant et ils lorgnaient d’un œil envieux les Espéranzais qui se la coulaient douce de l’autre côté des montagnes. Mais de l’avis général, et de celui des journalistes espéranzais, Tenebra, écrivaient-ils, méritait bien ses ennuis ce qui déclenchait immanquablement la colère des Ténébrais et entraînait le rappel de leurs ambassadeurs pour consultation et riposte éventuelle.
Un dernier mot : le pays Esperanza, capitale Constantz (écrit parfois Constantza à l’américaine), existe bel et bien, inutile de le rappeler. Son territoire est presque essentiellement composé de montagnes et de déserts caillouteux. Seule une bande de terre proche de la mer est fertile et par conséquent très peuplée. À cette époque son gouvernement, faible et pusillanime confiait ses usines, ses théâtres, ses chemins de fer et la défense du pays à une bande d’incapables regroupés sous le terme vague de la Compagnie. Nous reparlerons d’elle moult fois.
Faisons maintenant un zoom rapide vers une petite communauté esperanzaise nommée Béni Farés, dont l’existence, parce qu’il y règne une forte cohésion sociale, est paisible à défaut d’être généreusement pourvue en biens de toutes sortes. Au moment où nous zoomons sur ce village un vieil avion, un « coucou estropié » selon l’argot des mécaniciens de la Compagnie, est en train de se poser dans un champ proche.
Faisons connaissance avec son passager, un étranger au village, donc un élément perturbateur, forcément. Prénommé Damien - son nom de famille n’a aucune importance car il n’eut pas d’héritiers-, ce passager, parce qu’il sera comme un renard enfermé dans un poulailler, provoquera involontairement la destruction de cette communauté. Une bavure en quelque sorte pour dire les choses autrement.
Il ne fut, cependant, pas le seul responsable.
Page 28 de "Retour à Béni Farès"
Le comité d’accueil -qui avait tant effrayé le chauffeur du ronfleur-, est composé de cinq individus enturbannés, de taille moyenne et maigres comme des pieux. Ils sont vêtus, comme le veut la tradition à Béni Farès, et autant que l’on puisse en juger, d’un empilement de pull-overs, de gilets et de chemises sous leur veste ainsi que d’amples pantalons en gros drap. Ils attendent assis à croupetons à l’ombre d’un buisson jouxtant la bicoque la plus proche. Ce sont les représentants des terribles Béni Fariens, les guerriers impitoyables de Donald Fuck, ceux qui ignorent la civilisation et les automobiles Tesla. Damien se rapproche d’eux à pas lents, au moindre geste hostile sa main droite est prête à empoigner la crosse d’un gros pistolet glissé dans sa ceinture. Mais à quoi bon ce geste, se dit-il puisque les munitions sont dans le sac qu’il traine derrière lui en soulevant la poussière, car cette terre quasi biblique n’est que poussière puante. Un sac militaire d’au moins cinquante kilos, une sorte de boulet de bagnard qui, même s’il n’est pas de fonte, est encombrant comme l’amour. Il avait bien tenté de le porter mais entre le premier pas et le deuxième, le sac avait pris un poids déraisonnable. Il faut dire qu’il avait mis dans ce sac tout ce qui lui était cher, plus des livres et même un dictionnaire de langue locale.
Compter sur son pistolet, même chargé, pour se défendre en cas de menace n’était que farce car, dans ce cas faire feu exige au moins de ne pas trembler. Or, comme il est dit plus haut, les cartouches étaient dans le sac, ainsi que l’exigeait le règlement du transport aérien de la Compagnie. Mais, se dit-il pour se réconforter, ces gens là-bas l’ignorent. Il sent quand même, alors qu’il lui reste cent mètres à parcourir, sa gorge soudain se dessécher jusqu’à ressembler à cette terre qu’il piétine. Il aurait préféré que Béni Farès soit vide, un décor pour tenir les rebelles à distance, ou mieux n’existe pas... Et puis, à quoi bon ravitailler en carburant des avions alors qu’il leur suffirait de ne pas voler pour que tout le monde soit tranquille ? Et à quoi bon faire la guerre, et pour qui et pourquoi ? se dit-il en tentant de chasser l’idée de sa mort, préoccupation qui accélère les battements de son cœur jusqu’au niveau d’un coureur cycliste grimpant le Ventoux. Il se sent petit, si petit, perdu à l’autre bout de la planète. Égaré comme un pingouin dans cette steppe appelée plateau des Chèvres, à côté du mont Pelu, de la chaine Zebzeb. Un endroit aussi hostile que la lune. Pour un pingouin.
Les Béni Fariens là-bas, le voyant arriver, se lèvent lentement. Et cette lenteur permet à notre héros de vérifie qu’ils sont bel et bien armés de fusils de chasse, heureusement portés à la bretelle. Armement plus que suffisant pour expédier le visiteur au paradis des mécréants. Ils le détaillent de leurs yeux sombres tandis que Damien avance vers eux d’un pas qui se veut nonchalant et assuré mais qui n’est, en réalité, que le pas d’un vieillard malade et courbatu.