 L’enfance d’un chef.
L’enfance d’un chef.
(Inédit)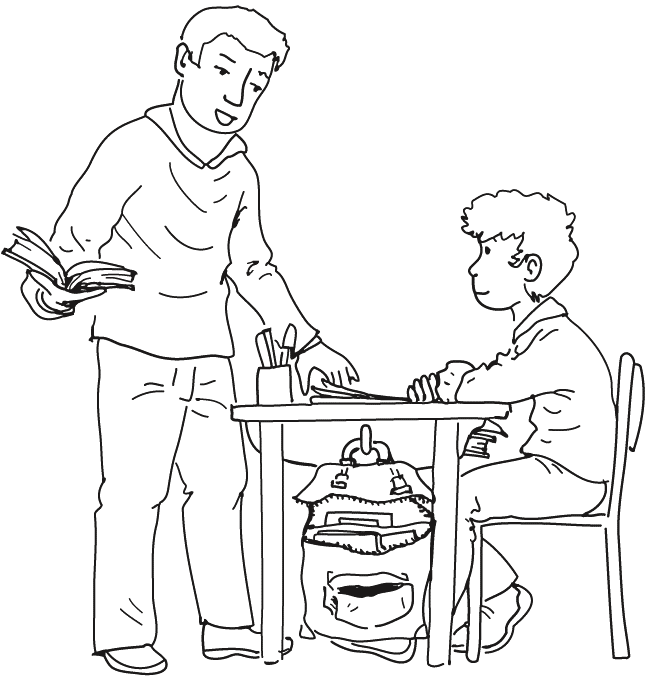
Arrivé de Paris la veille au soir, il était monté dans le grenier dès son petit déjeuner avalé afin d’inventorier, et trier, l’invraisemblable bric–à-brac accumulé par ses parents. Il ne pensait pas en terminer avant cinq heures ce soir, heure à laquelle les chiffonniers d’Emmaüs devaient passer prendre les meubles et le reste. Quand son père et sa mère étaient encore de ce monde c’est lui qui avait la charge du grenier. C’est lui qui devait y chercher, ou y ranger, l’objet qui tout à coup les encombrait ou qui, inversement, leur manquait et dont ils craignaient la disparition. « Tu l’as jeté, disait son père à l’adresse de sa mère, toi et ton maudit sens du rangement. » « Tu ne sais même plus ce que tu fais de tes affaires, ripostait-elle, tu as dû demander à Antoine de le monter. » Et aussitôt Antoine grimpait l’échelle de meunier pour aller vérifier. Depuis qu’il habitait dans la capitale, ils attendaient sa visite pour lui faire jouer les déménageurs. À peine descendu de voiture, il devait emprunter l’échelle devenue branlante avec le temps qui menait à leur capharnaüm, c’était aussi incontournable qu’un règlement de police. On aurait dit qu’il fallait qu’il accomplisse cette sorte de prouesse avant de reprendre sa place au sein de la famille. Une manière de vérifier son état de santé. « Ne vas pas te casser une jambe sur cette échelle ! » criait pourtant sa mère en cherchant à le retenir par sa veste. Son père, qui possédait sur le bout des doigts toutes les répliques de leur comédie conjugale, ripostait qu’Antoine avait de bonnes jambes et une bonne vue. J’étais leur fils nom d’un chien et pas n’importe quel freluquet ! "C’est aussi un député," ajoutait-il en se rengorgeant.
Maintenant qu’ils étaient morts tous les deux, il fallait vider la villa pour la vendre. Il était hors de question pour lui de vivre à Royan, ou même d’y séjourner pendant les vacances. Ni Cécilia, qui détestait Royan, ni lui n’aimaient la mer. Ils aimaient juste la montagne et un peu la campagne. Une énorme perte de temps, disait-il méprisant, en parlant de ceux qui se font bronzer, allongés sur la plage du matin jusqu’au soir. Et que dire des seins nus, complétait Cécilia. Un comportement avachi à l’opposé de l’esprit sportif et de l’amour de la nature, les deux composantes principales de ses discours électoraux. Composantes qui pouvaient se décliner « en activité de plein air » synonyme de travail à la ferme. Toujours très bien vue, l’agriculture. « En bénévolat sans quoi rien ne marcherait en France » et « en environnement à protéger pour la survie des générations futures ». Très prisé également des électeurs les forces vives regroupées, bénévolement, autour des générations futures.
Il devait tout à son père. Une formule creuse et usée qu’il glissait pourtant dans ses discours lorsqu’il devait traiter de la famille devant ses électeurs. À son corps défendant parfois, c’est vrai, mais il lui devait tout, c’était indéniable. Sa réussite scolaire, Normale Sup. et l’ENA, études qui l’avaient mené d’Hiersac, un petit village de Charente, jusqu’à l’Assemblée Nationale. Son père, un caractère ferme et droit, qui avait fait de son fils un bûcheur peu sentimental et très attaché aux principes. « Une personnalité forte, avait écrit récemment à son propos un chroniqueur politique, un homme généreux et un dialecticien capable de défendre ses idées pied à pied qui avait séduit le chef de son parti ». Son père avait été instituteur. Instituteur de la naissance à la mort, aurait été une bonne épitaphe s’il avait eu un tombeau. Un grand entiché du Bled, (grammaire et orthographe), des Choix de lecture de Mironneau, du Courtier et Grill, (croisement de trains et robinets de baignoires), et surtout de Sully Prudhomme, prix Nobel de littérature, pour les récitations et morales. Le seul auteur, affirmait son père catégorique, à avoir mérité ce prix. Il exagérait, pensait le fils aujourd’hui, Sully Prudhomme fabriquait techniquement des vers, sans plus. Mais à cette époque il se serait bien gardé de le contredire.
Ils étaient tous là, ces grands pédagogues, soigneusement rangés dans une malle avec les Jules Verne, les Anatole France, les Jean Aicard, les Erckmann-Chatrian, les Edmond Perrier et autres G.Bruno dont il pouvait lire les noms sur les tranches presque neuves. C’était dans ces bouquins vénérés et manipulés avec un soin extrême que son père puisait ses dictées. Elles étaient réputées si difficiles que même les autres instituteurs n’osaient s’y frotter de peur de faire eux-mêmes des fautes. Il se souvenait de sa voix puissante, légèrement éraillée par les cigarettes, des gitanes maïs, qui dictait en marchant lentement entre les rangs.
- « A deux heures(virgule) entra monsieur le pasteur Speck (Speck est inscrit au tableau, ceux qui feront une faute auront deux points en moins) avec ses larges souliers carrés au bout de ses grandes jambes maigres et sa longue redingote marron… J’ai l’honneur d’annoncer à la compagnie que les cigognes sont arrivées… Aussitôt les échos de la brasserie répétèrent dans tous les coins : Les cigognes sont arrivées ! (point d’exclamation) Les cigognes sont arrivées ! (point d’exclamation )… » Ou encore cet autre morceau de bravoure : « Fulton (Fulton est inscrit au tableau, etc.) naquit aux Etats Unis de parents très pauvres. (Point) Il ne put que très difficilement réaliser son rêve : fabriquer un bateau à vapeur… un Français, dénommé Andrieux (inscrit au tableau…) fut le premier à lui verser six dollars pour prix d’une traversée de l’Atlantique ce qui fit couler des larmes de bonheur sur les joues du bon monsieur Fulton. » Aujourd'hui, il était encore capable de réciter presque entièrement certaines d’entre elles. Des dictées où il faisait zéro faute ; et une faute à celle de Mérimée. Alors qu'aujourd'hui les étudiants eux mêmes... Quelle destination donner à ces reliques d’un autre âge ? Il fit plusieurs paquets et en nota le contenu sur le papier d’emballage. Il ramènera tout ça à Paris et avisera. Ce n’était pas le genre de chose qui intéressait les chiffonniers, en outre c’étaient des objets trop intimes, trop personnels pour les abandonner ainsi aux mains de n’importe qui. Il avait lu ces livres, et son père les avait utilisés et manipulés avec un immense respect.
Maintenant qu’ils étaient morts tous les deux, il fallait vider la villa pour la vendre. Il était hors de question pour lui de vivre à Royan, ou même d’y séjourner pendant les vacances. Ni Cécilia, qui détestait Royan, ni lui n’aimaient la mer. Ils aimaient juste la montagne et un peu la campagne. Une énorme perte de temps, disait-il méprisant, en parlant de ceux qui se font bronzer, allongés sur la plage du matin jusqu’au soir. Et que dire des seins nus, complétait Cécilia. Un comportement avachi à l’opposé de l’esprit sportif et de l’amour de la nature, les deux composantes principales de ses discours électoraux. Composantes qui pouvaient se décliner « en activité de plein air » synonyme de travail à la ferme. Toujours très bien vue, l’agriculture. « En bénévolat sans quoi rien ne marcherait en France » et « en environnement à protéger pour la survie des générations futures ». Très prisé également des électeurs les forces vives regroupées, bénévolement, autour des générations futures.
Il devait tout à son père. Une formule creuse et usée qu’il glissait pourtant dans ses discours lorsqu’il devait traiter de la famille devant ses électeurs. À son corps défendant parfois, c’est vrai, mais il lui devait tout, c’était indéniable. Sa réussite scolaire, Normale Sup. et l’ENA, études qui l’avaient mené d’Hiersac, un petit village de Charente, jusqu’à l’Assemblée Nationale. Son père, un caractère ferme et droit, qui avait fait de son fils un bûcheur peu sentimental et très attaché aux principes. « Une personnalité forte, avait écrit récemment à son propos un chroniqueur politique, un homme généreux et un dialecticien capable de défendre ses idées pied à pied qui avait séduit le chef de son parti ». Son père avait été instituteur. Instituteur de la naissance à la mort, aurait été une bonne épitaphe s’il avait eu un tombeau. Un grand entiché du Bled, (grammaire et orthographe), des Choix de lecture de Mironneau, du Courtier et Grill, (croisement de trains et robinets de baignoires), et surtout de Sully Prudhomme, prix Nobel de littérature, pour les récitations et morales. Le seul auteur, affirmait son père catégorique, à avoir mérité ce prix. Il exagérait, pensait le fils aujourd’hui, Sully Prudhomme fabriquait techniquement des vers, sans plus. Mais à cette époque il se serait bien gardé de le contredire.
Ils étaient tous là, ces grands pédagogues, soigneusement rangés dans une malle avec les Jules Verne, les Anatole France, les Jean Aicard, les Erckmann-Chatrian, les Edmond Perrier et autres G.Bruno dont il pouvait lire les noms sur les tranches presque neuves. C’était dans ces bouquins vénérés et manipulés avec un soin extrême que son père puisait ses dictées. Elles étaient réputées si difficiles que même les autres instituteurs n’osaient s’y frotter de peur de faire eux-mêmes des fautes. Il se souvenait de sa voix puissante, légèrement éraillée par les cigarettes, des gitanes maïs, qui dictait en marchant lentement entre les rangs.
- « A deux heures(virgule) entra monsieur le pasteur Speck (Speck est inscrit au tableau, ceux qui feront une faute auront deux points en moins) avec ses larges souliers carrés au bout de ses grandes jambes maigres et sa longue redingote marron… J’ai l’honneur d’annoncer à la compagnie que les cigognes sont arrivées… Aussitôt les échos de la brasserie répétèrent dans tous les coins : Les cigognes sont arrivées ! (point d’exclamation) Les cigognes sont arrivées ! (point d’exclamation )… » Ou encore cet autre morceau de bravoure : « Fulton (Fulton est inscrit au tableau, etc.) naquit aux Etats Unis de parents très pauvres. (Point) Il ne put que très difficilement réaliser son rêve : fabriquer un bateau à vapeur… un Français, dénommé Andrieux (inscrit au tableau…) fut le premier à lui verser six dollars pour prix d’une traversée de l’Atlantique ce qui fit couler des larmes de bonheur sur les joues du bon monsieur Fulton. » Aujourd'hui, il était encore capable de réciter presque entièrement certaines d’entre elles. Des dictées où il faisait zéro faute ; et une faute à celle de Mérimée. Alors qu'aujourd'hui les étudiants eux mêmes... Quelle destination donner à ces reliques d’un autre âge ? Il fit plusieurs paquets et en nota le contenu sur le papier d’emballage. Il ramènera tout ça à Paris et avisera. Ce n’était pas le genre de chose qui intéressait les chiffonniers, en outre c’étaient des objets trop intimes, trop personnels pour les abandonner ainsi aux mains de n’importe qui. Il avait lu ces livres, et son père les avait utilisés et manipulés avec un immense respect.
Dehors, à l’autre bout du jardin, la marée haute battait son plein et l’océan cognait contre les rochers qui bordent l’ancien chemin des douaniers. Avec sa vue sur la mer, songea-t-il, la villa et son jardin se vendront bien. Du fait de l’arrivée prochaine de l’autoroute, l’immobilier est en plein boum dans la région, lui avait confié son ami le Secrétaire d’état au tourisme. Elle était aussi à deux pas du Garden, une sorte de centre de loisirs où son père allait bridger et où lui-même avait disputé quelques tournois de tennis lorsqu’il venait passer deux ou trois jours en famille. Un sport qu’il pratiquait encore avec sa femme et son aîné. Sa silhouette devait être celle d’un homme jeune et peu importait son âge réel. Ce qui comptait c’était l’apparence, l’image. Il se teignait les cheveux pour la même raison. Ses parents avaient acheté cette villa lorsque son père avait atteint l’âge de la retraite. Ils avaient fait mouvement vers la côte avec tout un bazar de caisses et de malles qui renfermaient quarante années d’apostolat scolaire. « C’est pour toi, pour ton biographe plus tard, » affirmait son père en montrant les caisses. Ce qui le faisait sourire. Qui écrit la biographie d’un député de nos jours ? Un peu avant de quitter l’Education nationale, son père avait été nommé directeur de l’école où il enseignait. Il en était très fier. Il avait même reçu les palmes académiques le jour de son départ.
Une caisse en bois contenait des cahiers de compositions récupérés avant que les élèves ne les détruisent. « Les cahiers au feu et le maître au milieu ! » chantait-on avant les vacances. « Ou bien vous les gardez pour vos enfants, ou vous me les donnez ! » exigeait alors le maître, outré que l’on puisse détruire ainsi ce qui faisait son fond de commerce. Au moins cinquante kilos de paperasses chargées bien souvent de larmes et de déceptions. Il en feuilleta quelques-uns. De bons élèves, appliqués, des cahiers propres avec les titres soulignés et des « Très bien » en marge, à l’encre rouge et à la plume de métal. Quelques élèves moyens ; et les classements, quatrième pour l’un, cinquième pour l’autre, ou dixième sur vingt cinq. Dans son cas personnel, toujours premier quoi qu’il arrive. Son père n’aurait pas toléré qu’il occupe une autre place, quitte parfois à tricher un peu. Par exemple en faisant à la maison, la veille et après le repas du soir, une dictée ou un problème très proche de celui de la composition.
Peu de cancres, semblait-il, lui avaient cédé leurs cahiers. Il tomba par hasard sur celui de Jeannot Lacase, son voisin en classe de la maternelle jusqu’au collège. Jeannot l’éternel dernier. « Peu de dons, sauf pour l’agriculture section élevage de pourceaux ! » avait tracé, rageur, l’encre rouge dans la marge. Tantôt, l’encre rouge prédisait à Jeannot une carrière de chômeur, tantôt il ne lui restait qu’à s’engager dans la Légion étrangère avant de finir à Tataouine. Même un modeste emploi de cantonnier lui semblait fermé, au-dessus de ses moyens. Peu de dons, répétait son père à chaque trimestre. Ce qui signifiait aucun don. He bien, Jeannot Lacase était maintenant styliste dans une maison de haute couture. « Peu de dons certes, disait-il encore aujourd’hui, car l’appréciation lui était restée sur l’estomac, mais du goût ». Il leur arrivait de dîner ensemble dans un petit restaurant du marais où Jeannot avait ses entrées. Invariablement ce dernier remettait la remarque de son père sur le tapi. Il mit le cahier de côté pour le lui offrir.
- Il aurait pu m’aider non ? râlait Jeannot, au lieu de se foutre de moi avec ses appréciations aigres-douces. Mon père était violent, il le savait bien. Ils n’étaient pas du même bord politique, mais ce n’était pas une raison. De toute façon, ce n’était pas utile de m’humilier, je ne risquais pas de te dépasser. Je n’avais aucun penchant pour le genre d’étude qu’il nous imposait, j’aspirais à plus de modernisme. Quant au collège, je m’y ennuyais comme un rat mort…
Les leçons de morale de son père étaient particulièrement soignées. « La fainéantise, écrivait-il au tableau d’une belle écriture anglaise, est la mère de tous les vices. Un fainéant n’arrive jamais à rien et est à la charge de la société. » Vlan ! Il ne l’envoyait pas dire, le vieux. Qui a été à la charge de la société dans ces paquets de cahiers qui couvraient plusieurs dizaines d’années ? Hervé Sola qui faisait l’école buissonnière ? Ou le grand Ferrand qui dormait l’après-midi sur son pupitre, ivre mort après avoir sifflé la topette de gnole, du mauvais cognac, que lui glissait son père dans son cartable avant qu’il ne parte pour l’école le matin ? Finalement c’était peut-être lui, le député, le fils de l’instit, qui était à la charge de la société ? Député et peut-être bientôt ministre, le Président en avait parlé à Lenoir vendredi dernier. Cependant il n’était pas fainéant, mais l’un pouvait aller sans l’autre.
 Un fainéant ça « bade » tout le temps, disait aussi son père. Du patois pour dire qu’il bayait aux corneilles. C’est même comme ça qu’on le reconnaît, ajoutait-il. Il eut un sourire. Pour ça, il n’aimait pas que son Antoine bade, ça non. Dès qu’il le voyait les mains dans les poches en train de regarder filer les nuages, ou simplement à rêvasser, allongé sur son lit, hop ! un problème de robinet ou une petite dictée sur le pouce. Même au petit déjeuner, il fallait qu’il révise. C’est ainsi qu’il avait appris à bader en ayant toujours l’air d’être occupé. Ce qui était bien pratique au moment des débats à l'Assemblée. Pour bader convenablement sous l’œil paternel, il lui fallait un livre dans la main, un livre de classe bien sûr, ou de la bibliothèque verte au pis. Il marmonnait les yeux au ciel, de l’air de se réciter des choses. En réalité il grommelait des jurons appris pendant les récréations. Ce pouvait-être aussi des bonbons, interdits à cause des dents, qu’il suçotait, avec l’air inspiré d’un sous-préfet aux champs en train de poétiser. Ou bien, allongé dans l’herbe, il donnait l’impression, avec sa loupe et son herbier, d’étudier les mœurs des fourmis ou la tournure d’une plante alors qu’il réfléchissait pour installer le piège à moineaux construit par le grand Ferrand. Quand l’autorité, satisfaite de ce qu’elle voyait s’était éloignée, il sortait l’illustré caché sous son pull ou rêvait, la tête vers les nuages.
Un fainéant ça « bade » tout le temps, disait aussi son père. Du patois pour dire qu’il bayait aux corneilles. C’est même comme ça qu’on le reconnaît, ajoutait-il. Il eut un sourire. Pour ça, il n’aimait pas que son Antoine bade, ça non. Dès qu’il le voyait les mains dans les poches en train de regarder filer les nuages, ou simplement à rêvasser, allongé sur son lit, hop ! un problème de robinet ou une petite dictée sur le pouce. Même au petit déjeuner, il fallait qu’il révise. C’est ainsi qu’il avait appris à bader en ayant toujours l’air d’être occupé. Ce qui était bien pratique au moment des débats à l'Assemblée. Pour bader convenablement sous l’œil paternel, il lui fallait un livre dans la main, un livre de classe bien sûr, ou de la bibliothèque verte au pis. Il marmonnait les yeux au ciel, de l’air de se réciter des choses. En réalité il grommelait des jurons appris pendant les récréations. Ce pouvait-être aussi des bonbons, interdits à cause des dents, qu’il suçotait, avec l’air inspiré d’un sous-préfet aux champs en train de poétiser. Ou bien, allongé dans l’herbe, il donnait l’impression, avec sa loupe et son herbier, d’étudier les mœurs des fourmis ou la tournure d’une plante alors qu’il réfléchissait pour installer le piège à moineaux construit par le grand Ferrand. Quand l’autorité, satisfaite de ce qu’elle voyait s’était éloignée, il sortait l’illustré caché sous son pull ou rêvait, la tête vers les nuages.
- Un député doit connaître tous les électeurs de sa circonscription, avait énoncé son père du ton d’un indiscutable axiome le jour de sa première élection.
- Mais s’il n’a pas le temps ou pas suffisamment de mémoire ? De nos jours papa, un député passe très peu de temps dans sa circonscription.
- Il fait alors comme le père Dupon, un vieux de la vieille d’avant la guerre. Quel est ton nom demandait-il à celui qui lui était inconnu. Je m’appelle X répondait l’interpellé. Je sais bien que tu t’appelles X, répliquait Dupon, ce que je te demande c’est ton prénom.
Il déconne, avait-il pensé. De nos jours ce genre de momerie ferait rire les gens de son parti et à l’ENA il passerait pour un farfelu peu digne de confiance. Je me vois demander le prénom de mes électeurs et électrices… Ses premiers amours avaient été contrariés, violemment, par son père qui prétendait qu’il aurait bien le temps plus tard de courir les filles. Bilan des décisions paternelles, il avait failli se marier puceau. Même sa mère, pourtant simple ménagère attachée au foyer comme un grillon, et grande amoureuse de son époux, lui déconseillait d’accepter les rendez-vous de ces filles « qui n’étaient pas pour lui ». Quand son père élevait la voix, elle préférait quitter la pièce. Malgré tout, elle avait participé, elle aussi, à sa réussite. En laissant faire son père, justement. Mais il faut reconnaître qu’à Hiersac, il n’y avait pas un grand choix de filles de son âge.
Pendant les grandes vacances, ils restaient sur place. Sa mère faisait des confitures, son père préparait la rentrée et lui, le fils unique, faisait des devoirs de vacances sur les cahiers de chez Nathan. Pas ceux de la classe qu’il venait de quitter, non ! Ceux de la classe où il allait entrer. « Tu me remercieras plus tard, Antoine ! » proclamait son père à chaque vacances gâchées. Ils étaient tous là ses cahiers de vacances, empilés dans une caissette en carton. Du CM1 au Bac, diplôme qu’il avait obtenu à seize ans, pour la plus grande gloire de la famille. Ce jour-là, il n’avait pensé qu’à une chose : Il allait enfin quitter Hiersac. Aujourd’hui, c’était au feu qu’ils allaient aller les cahiers ! Il y avait une cheminée en bas dans le salon. Sous les cahiers, il découvrit un paquet, un objet plat de la taille d’un grand livre, emballé dans du papier kraft. Ce puritain, cet obsédé du travail scolaire avait donc des secrets ? Un livre à ne pas mettre entre toutes les mains ? À moins que ce soit une collection de photos polissonnes, pourquoi pas. Ou des lettres. Son père aurait eu une liaison ? Hum ! ça ne correspondait pas au personnage, si empesé, si peu soucieux d’amour. Une fois l’objet déballé il vit qu’il s’agissait d’une ardoise d’écolier. Une ficelle assez longue passait par deux trous et permettait de la suspendre. Trois mots en partie effacés mais encore bien lisibles s’étalaient sur toute l’ardoise. Il n’était pas nécessaire qu’il les déchiffre ; après une sorte de déclic de sa mémoire, ils avaient jailli sous son crâne avec leur cortège de fureur et d’images nauséeuses : VOLEUR ET MENTEUR.
à suivre,
Une caisse en bois contenait des cahiers de compositions récupérés avant que les élèves ne les détruisent. « Les cahiers au feu et le maître au milieu ! » chantait-on avant les vacances. « Ou bien vous les gardez pour vos enfants, ou vous me les donnez ! » exigeait alors le maître, outré que l’on puisse détruire ainsi ce qui faisait son fond de commerce. Au moins cinquante kilos de paperasses chargées bien souvent de larmes et de déceptions. Il en feuilleta quelques-uns. De bons élèves, appliqués, des cahiers propres avec les titres soulignés et des « Très bien » en marge, à l’encre rouge et à la plume de métal. Quelques élèves moyens ; et les classements, quatrième pour l’un, cinquième pour l’autre, ou dixième sur vingt cinq. Dans son cas personnel, toujours premier quoi qu’il arrive. Son père n’aurait pas toléré qu’il occupe une autre place, quitte parfois à tricher un peu. Par exemple en faisant à la maison, la veille et après le repas du soir, une dictée ou un problème très proche de celui de la composition.
Peu de cancres, semblait-il, lui avaient cédé leurs cahiers. Il tomba par hasard sur celui de Jeannot Lacase, son voisin en classe de la maternelle jusqu’au collège. Jeannot l’éternel dernier. « Peu de dons, sauf pour l’agriculture section élevage de pourceaux ! » avait tracé, rageur, l’encre rouge dans la marge. Tantôt, l’encre rouge prédisait à Jeannot une carrière de chômeur, tantôt il ne lui restait qu’à s’engager dans la Légion étrangère avant de finir à Tataouine. Même un modeste emploi de cantonnier lui semblait fermé, au-dessus de ses moyens. Peu de dons, répétait son père à chaque trimestre. Ce qui signifiait aucun don. He bien, Jeannot Lacase était maintenant styliste dans une maison de haute couture. « Peu de dons certes, disait-il encore aujourd’hui, car l’appréciation lui était restée sur l’estomac, mais du goût ». Il leur arrivait de dîner ensemble dans un petit restaurant du marais où Jeannot avait ses entrées. Invariablement ce dernier remettait la remarque de son père sur le tapi. Il mit le cahier de côté pour le lui offrir.
- Il aurait pu m’aider non ? râlait Jeannot, au lieu de se foutre de moi avec ses appréciations aigres-douces. Mon père était violent, il le savait bien. Ils n’étaient pas du même bord politique, mais ce n’était pas une raison. De toute façon, ce n’était pas utile de m’humilier, je ne risquais pas de te dépasser. Je n’avais aucun penchant pour le genre d’étude qu’il nous imposait, j’aspirais à plus de modernisme. Quant au collège, je m’y ennuyais comme un rat mort…
Les leçons de morale de son père étaient particulièrement soignées. « La fainéantise, écrivait-il au tableau d’une belle écriture anglaise, est la mère de tous les vices. Un fainéant n’arrive jamais à rien et est à la charge de la société. » Vlan ! Il ne l’envoyait pas dire, le vieux. Qui a été à la charge de la société dans ces paquets de cahiers qui couvraient plusieurs dizaines d’années ? Hervé Sola qui faisait l’école buissonnière ? Ou le grand Ferrand qui dormait l’après-midi sur son pupitre, ivre mort après avoir sifflé la topette de gnole, du mauvais cognac, que lui glissait son père dans son cartable avant qu’il ne parte pour l’école le matin ? Finalement c’était peut-être lui, le député, le fils de l’instit, qui était à la charge de la société ? Député et peut-être bientôt ministre, le Président en avait parlé à Lenoir vendredi dernier. Cependant il n’était pas fainéant, mais l’un pouvait aller sans l’autre.
 Un fainéant ça « bade » tout le temps, disait aussi son père. Du patois pour dire qu’il bayait aux corneilles. C’est même comme ça qu’on le reconnaît, ajoutait-il. Il eut un sourire. Pour ça, il n’aimait pas que son Antoine bade, ça non. Dès qu’il le voyait les mains dans les poches en train de regarder filer les nuages, ou simplement à rêvasser, allongé sur son lit, hop ! un problème de robinet ou une petite dictée sur le pouce. Même au petit déjeuner, il fallait qu’il révise. C’est ainsi qu’il avait appris à bader en ayant toujours l’air d’être occupé. Ce qui était bien pratique au moment des débats à l'Assemblée. Pour bader convenablement sous l’œil paternel, il lui fallait un livre dans la main, un livre de classe bien sûr, ou de la bibliothèque verte au pis. Il marmonnait les yeux au ciel, de l’air de se réciter des choses. En réalité il grommelait des jurons appris pendant les récréations. Ce pouvait-être aussi des bonbons, interdits à cause des dents, qu’il suçotait, avec l’air inspiré d’un sous-préfet aux champs en train de poétiser. Ou bien, allongé dans l’herbe, il donnait l’impression, avec sa loupe et son herbier, d’étudier les mœurs des fourmis ou la tournure d’une plante alors qu’il réfléchissait pour installer le piège à moineaux construit par le grand Ferrand. Quand l’autorité, satisfaite de ce qu’elle voyait s’était éloignée, il sortait l’illustré caché sous son pull ou rêvait, la tête vers les nuages.
Un fainéant ça « bade » tout le temps, disait aussi son père. Du patois pour dire qu’il bayait aux corneilles. C’est même comme ça qu’on le reconnaît, ajoutait-il. Il eut un sourire. Pour ça, il n’aimait pas que son Antoine bade, ça non. Dès qu’il le voyait les mains dans les poches en train de regarder filer les nuages, ou simplement à rêvasser, allongé sur son lit, hop ! un problème de robinet ou une petite dictée sur le pouce. Même au petit déjeuner, il fallait qu’il révise. C’est ainsi qu’il avait appris à bader en ayant toujours l’air d’être occupé. Ce qui était bien pratique au moment des débats à l'Assemblée. Pour bader convenablement sous l’œil paternel, il lui fallait un livre dans la main, un livre de classe bien sûr, ou de la bibliothèque verte au pis. Il marmonnait les yeux au ciel, de l’air de se réciter des choses. En réalité il grommelait des jurons appris pendant les récréations. Ce pouvait-être aussi des bonbons, interdits à cause des dents, qu’il suçotait, avec l’air inspiré d’un sous-préfet aux champs en train de poétiser. Ou bien, allongé dans l’herbe, il donnait l’impression, avec sa loupe et son herbier, d’étudier les mœurs des fourmis ou la tournure d’une plante alors qu’il réfléchissait pour installer le piège à moineaux construit par le grand Ferrand. Quand l’autorité, satisfaite de ce qu’elle voyait s’était éloignée, il sortait l’illustré caché sous son pull ou rêvait, la tête vers les nuages.- Un député doit connaître tous les électeurs de sa circonscription, avait énoncé son père du ton d’un indiscutable axiome le jour de sa première élection.
- Mais s’il n’a pas le temps ou pas suffisamment de mémoire ? De nos jours papa, un député passe très peu de temps dans sa circonscription.
- Il fait alors comme le père Dupon, un vieux de la vieille d’avant la guerre. Quel est ton nom demandait-il à celui qui lui était inconnu. Je m’appelle X répondait l’interpellé. Je sais bien que tu t’appelles X, répliquait Dupon, ce que je te demande c’est ton prénom.
Il déconne, avait-il pensé. De nos jours ce genre de momerie ferait rire les gens de son parti et à l’ENA il passerait pour un farfelu peu digne de confiance. Je me vois demander le prénom de mes électeurs et électrices… Ses premiers amours avaient été contrariés, violemment, par son père qui prétendait qu’il aurait bien le temps plus tard de courir les filles. Bilan des décisions paternelles, il avait failli se marier puceau. Même sa mère, pourtant simple ménagère attachée au foyer comme un grillon, et grande amoureuse de son époux, lui déconseillait d’accepter les rendez-vous de ces filles « qui n’étaient pas pour lui ». Quand son père élevait la voix, elle préférait quitter la pièce. Malgré tout, elle avait participé, elle aussi, à sa réussite. En laissant faire son père, justement. Mais il faut reconnaître qu’à Hiersac, il n’y avait pas un grand choix de filles de son âge.
Pendant les grandes vacances, ils restaient sur place. Sa mère faisait des confitures, son père préparait la rentrée et lui, le fils unique, faisait des devoirs de vacances sur les cahiers de chez Nathan. Pas ceux de la classe qu’il venait de quitter, non ! Ceux de la classe où il allait entrer. « Tu me remercieras plus tard, Antoine ! » proclamait son père à chaque vacances gâchées. Ils étaient tous là ses cahiers de vacances, empilés dans une caissette en carton. Du CM1 au Bac, diplôme qu’il avait obtenu à seize ans, pour la plus grande gloire de la famille. Ce jour-là, il n’avait pensé qu’à une chose : Il allait enfin quitter Hiersac. Aujourd’hui, c’était au feu qu’ils allaient aller les cahiers ! Il y avait une cheminée en bas dans le salon. Sous les cahiers, il découvrit un paquet, un objet plat de la taille d’un grand livre, emballé dans du papier kraft. Ce puritain, cet obsédé du travail scolaire avait donc des secrets ? Un livre à ne pas mettre entre toutes les mains ? À moins que ce soit une collection de photos polissonnes, pourquoi pas. Ou des lettres. Son père aurait eu une liaison ? Hum ! ça ne correspondait pas au personnage, si empesé, si peu soucieux d’amour. Une fois l’objet déballé il vit qu’il s’agissait d’une ardoise d’écolier. Une ficelle assez longue passait par deux trous et permettait de la suspendre. Trois mots en partie effacés mais encore bien lisibles s’étalaient sur toute l’ardoise. Il n’était pas nécessaire qu’il les déchiffre ; après une sorte de déclic de sa mémoire, ils avaient jailli sous son crâne avec leur cortège de fureur et d’images nauséeuses : VOLEUR ET MENTEUR.
à suivre,